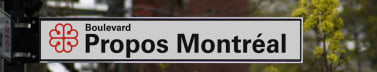À New York, nommé en 1962 dans un rapport d'urbanisme par Chester Rapkin, le quartier de SoHo, pour « South of Houston Street », est devenu une désignation spontanée adoptée par les artistes puis par les promoteurs. Ce type de succès toponymique a souvent été imité mais rarement avec le même succès.
À Montréal, historiquement, les noms de quartier sont tirés du manoir de l'ancien seigneur, comme Monkland Village ou de l'usage populaire, comme le « McGill Ghetto ». Or, depuis l'industrialisation, ce sont souvent des stratèges de marque via des boîtes de communication mandatées par des promoteurs immobiliers qui les nomment avant même la première pelletée de terre.
Je tiens à préciser que je n'ai absolument rien contre les quartiers, passé ou futur, que je vais mentionner ici. On ne parle que de leur désignation, que de leur nom. On vit maintenant dans le Mile-Ex, dans Angus ou bientôt dans le Quartier des Lumières. Des noms récents, accolés sur des terrains développés ou à redévelopper pour raconter une histoire vendable.
À Montréal, la tendance de quartier-marketing ne date pas d’hier. Pensons à Ville-Émard, nommé par le promoteur Joseph-Ulric Émard en 1908, ou Rosemont, baptisé au début du 20e siècle par le promoteur immobilier Ucal-Henri Dandurand, en hommage à sa mère Rose Phillips. Il fallait un nom pour vendre des terrains aux ouvriers des usines Angus. Mission accomplie.
Plus récemment, le Mile-Ex s'est imposé comme une étiquette commode pour ce petit rectangle entre le Mile-End et Parc-Extension. Ni les résidents, ni les cartes, ni la Ville ne l'utilisaient avant les années 2000. Mais les promoteurs immobiliers, voulant étirer le Mile-End à la mode, ont compris l'avantage d'un branding efficace. Aujourd'hui, on parle du Mile-Ex comme s'il avait toujours existé.
D'autres noms peinent à percer le zeitgeist populaire. Le Quartier des Gares, par exemple, est un espace bien réel entre les gares Lucien-L'Allier et Centrale où historiquement on retrouvait plusieurs terminus ferroviaires. Mais ce toponyme récent, né d'un plan d'urbanisme dans le cadre du 375e de Montréal de Denis Coderre, existe principalement dans les documents de planification et les communiqués.
Avec l'émergence de plusieurs nouveaux quartiers, je me demande quels noms vont prendre racine et lesquels seront mis aux oubliettes.
Le Quartier des Lumières, qui remplace les terrains de l'ancienne Maison Radio-Canada. Un nom inspiré en référence à son patrimoine télévisuel et nommé par le promoteur derrière le projet.
De l'autre côté de la rue, nous aurons le Quartier Molson, sur les ruines de l'usine du même nom, recyclage d'une mémoire populaire pour vendre un nouveau mode de vie. Le Quartier Royalmount, Bridge-Bonaventure, Quartier Angrignon ou Quartier Namur-Hippodrome, dans tous ces cas, les noms n'ont rien d'organique et arrivent avant l'identité, avant même les premiers locataires.

L'importance d'un nom
Nommer, c'est exercer un pouvoir. C'est tenter de façonner une réalité plutôt que de l'observer. En créant un nom accrocheur, on fabrique un désir. On ne dit plus « un terrain vague au coin de De Lorimier », on va dire « le futur Quartier Cartier ».
D’ailleurs, cet appât du gain a souvent pour effet d'accélérer l’embourgeoisement. En rebaptisant un secteur avec une appellation plus séduisante, on change la perception du lieu dans l'imaginaire collectif.
Ce simple geste linguistique peut provoquer une montée rapide des loyers, attirer des investisseurs oui, mais graduellement pousser les résidents d'origine vers la sortie.
Un lieu de vie, ce n'est pas un slogan. C'est un réseau de liens et d'habitudes, comme Goose Village, dû à la chasse aux oies par les Premières Nations ou La Petite-Patrie littéralement tiré d’un roman de 1972 par Claude Jasmin
Autrefois le fief Nazareth, Griffintown est nommé de façon organique au moment de l'histoire où la propriétaire des terres est Mary Griffin. Quand celle-ci est forcée par la justice de revendre le lotissement à Thomas McCord, le nom reste tout de même figé dans le temps. Si aujourd'hui « La Griff » n'est plus ce qu'elle était, le nom rappelle toutefois un territoire vécu, pas seulement projeté.
Baptisé en 2010, pouvez-vous me dire où se trouve le quartier « Le Triangle » ? Eh bien non, justement! Le danger avec les noms trop pensés, trop stratégiques, c'est qu'ils collent une histoire qui ne vient pas des gens, mais d'une vision d'en haut par des personnes qui n'ont jamais et qui n'habiterons jamais ce secteur.

Ma prédiction, absolument personne ne va dire qu'ils habitent le Quartier des Lumières, ce sera encore et toujours le Centre-Sud, le secteur Radio-Canada ou peut être la résurrection du Faubroug à m’lasse.
Rappelez-vous qu'un quartier, ne naît pas d’un PowerPoint ou d’une discussion sur Slack.