Les rues de la Commune et Saint-Paul qui séparent le Vieux-Port du Vieux-Montréal sont, durant l’été, le festival du touriste. En fait, la grande majorité des 11 millions de touristes à venir à Montréal chaque année passeront sur ces pavés.
De l’autre côté du spectre, le Montréalais et la Montréalaise moyens, encore plus s’ils sont en voiture, se tiennent loin de ce secteur sauf pour aller à un endroit bien précis. La rue de la Commune est une destination, pas une voie de passage.
Comme tout bon endroit touristique partout dans le monde, Montréal cherche à améliorer le secteur pour le public principal en transformant le secteur en une zone à priorité piétonne.
À la différence d’une piétonnisation, les gestes déployés favorisent la mobilité et le confort des piétonnes et des piétons, sans limiter l’accès aux résidences et aux commerces. Alors si vous êtes en voiture, rien ne vous empêche d’y aller, mais ne vous attendez pas à rouler à 50 km/h mais plus comme 5 km/h
Or voilà que la Société du Vieux-Port, un organisme fédéral, s’oppose à cette idée puisque leurs vaches à lait, les stationnements, seront probablement plus difficiles à atteindre.
Ce genre de réaction illustre le décalage entre la perception initiale et la réalité mesurable une fois la piétonnisation en place. En effet, plusieurs expériences, à Montréal comme ailleurs, montrent que les rues piétonnes finissent souvent par attirer davantage de visiteurs et dynamiser le quartier, à condition d’être bien conçues.
Il suffit de regarder quelques exemples montréalais récents. L’avenue du Mont-Royal, au cœur du Plateau, est devenue piétonne l’été à partir de 2020. Malgré les doutes initiaux, le projet a vite trouvé son public. L’ambiance conviviale et la liberté de flâner ont plu aux résidents comme aux touristes. En 2023, la Ville a même prolongé la piétonnisation jusqu’à l’automne, constatant son succès.
La Société de développement de l’avenue du Mont-Royal parle elle aussi d’un bilan positif et, forte de cette expérience, la Ville a décidé de reconduire le projet pour les années à venir « Leur succès étant maintenant démontré, les projets de piétonnisation touchés pourront bénéficier d’une enveloppe récurrente et améliorée », explique-t-on du côté municipal.
La rue Wellington à Verdun est piétonnisée chaque été depuis 2020 et les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2021, le trafic piétonnier sur Wellington avait augmenté de 17 % par rapport à l’année précédente.
L’ambiance de la rue commerciale, agrémentée de terrasses et d’aménagements, en a fait un lieu très prisé ayant même été consacrée « rue la plus cool au monde » par le magazine Time Out. Cette vitalité se répercute sur le tissu commercial local et selon une étude citée par la SDC Wellington, les rues piétonnes encouragent l’activité commerciale et génèrent plus de revenus que des rues axées sur la voiture. Contrairement aux craintes fréquentes, on constate généralement que les fameuses peurs des commerçants s’avèrent infondées une fois le projet en place.
Tous les projets de piétonnisation ne connaissent pas un succès unanime. La Plaza Saint-Hubert, dans Rosemont–La Petite-Patrie, en est un exemple nuancé. Durant l’été 2024, cette artère commerciale a tenté une piétonnisation pilote. Du point de vue des usagers, ce fut un triomphe. 88 % des citoyens consultés se sont dits favorables à la rue piétonne, et l’achalandage a bondi de +85 % par rapport à un été normal.
Pourtant, beaucoup de commerçants ont perçu la situation différemment. Privés de la circulation automobile, certains ont constaté une baisse des ventes d’environ 7 % sur la saison. Selon un sondage de la SDC Plaza St-Hubert, 61 % des commerçants étaient défavorables à prolonger l’expérience.
Résultat, malgré l’animation évidente sur la rue, l’arrondissement a choisi de ne pas reconduire le projet l’année suivante.
Le cas de Saint-Hubert montre que la réussite d’une rue piétonne repose sur un équilibre, l’acceptation des commerçants, la présence d’une masse critique de clients à pied, et des ajustements (livraisons, propreté, sécurité) pour répondre aux préoccupations. Il n’en demeure pas moins que l’essai a prouvé l’attrait du concept pour le public, ce qui pourrait, souhaitons-le, ouvrir la voie à de nouvelles approches ou à un retour bonifié du projet plus tard.
Ailleurs dans le monde.
Montréal à ce je ne sais quoi comme dise les touristes, mais force est d’admettre que c’est une ville nord-américaine comme aiment me dire certaines personnes.
En Europe et en Asie, on retrouve moins ce fossé initial entre peur et réalité, comblé à force de résultats positifs. Nice, en France, a par exemple aménagé depuis longtemps une vaste zone piétonne autour de la place Masséna, au cœur du centre-ville. Cette place emblématique, entièrement partagée entre piétons et tramway, est devenue un poumon économique et social de Nice, reliant la vieille ville au quartier commercial qui n’est pas sans rappeler le Vieux-Montréal.
À Londres, un exemple fameux est Carnaby Street, petite rue de Soho qui fut au cœur de la mode dans les années 1960. Piétonnisée dès 1973, elle a vu instantanément le nombre de passants augmenter de 30 %. Carnaby Street s’est transformée en promenade branchée, avec ses boutiques éclectiques, ses pubs et son arche “Welcome to Carnaby”.
Les données récentes indiquent que la fréquentation et les ventes dans le quartier de Carnaby sont en forte croissance, supérieure même aux niveaux prépandémie. Ce succès durable illustre bien comment une intégration bien pensée peut revitaliser un secteur et renforcer son attractivité au fil du temps, au-delà de l’effet de nouveauté initial.
Dubrovnik, en Croatie, dont le centre historique entièrement piéton est littéralement pris d’assaut par les visiteurs? La principale artère de cette cité médiévale ceinte de remparts avec au centre, la Stradun, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la vieille ville de Dubrovnik tire l’essentiel de son économie du tourisme piétonnier.
En 2019, on a compté 36 touristes pour chaque habitant sur l’année, un ratio record en Europe, qui témoigne de la popularité extraordinaire de cette destination. La Stradun elle-même figure parmi les « rues à voir une fois dans sa vie » selon The Telegraph.
Donc, à ceux qui me disent que Montréal ce n’est pas l’Europe, je réponds habituellement « et pourquoi pas? » S’ils font quelque chose avec succès, on va s’abstenir de le faire parce que nous sommes en Amérique du Nord?
Des statistiques
Bien sûr, chaque contexte a ses spécificités et une rue piétonne n’apporte pas automatiquement un succès commercial instantané. Mais globalement, la fréquentation augmente et l’offre commerciale s’adapte positivement dans la plupart des cas étudiés. Une analyse de plusieurs artères à Montréal a même révélé qu’une plus grande présence de stationnement était corrélée à davantage de commerces vacants, tandis que les rues piétonnes s’avèrent généralement plus productives économiquement et offrent un meilleur retour fiscal pour la collectivité.
Du côté de Londres, l’organisation Living Streets a compilé des recherches montrant que le fait de piétonniser peut faire grimper l’achalandage et les ventes jusqu’à 30 % dans une zone commerciale.
Les bénéfices ne sont pas qu’économiques d’ailleurs : la sécurité routière s’améliore, la pollution et le bruit diminuent, la qualité de vie et le sentiment d’appartenance augmentent autour des espaces apaisés. À Montréal, Piétons Québec s’attend à un « impact positif au niveau touristique » dans le Vieux-Montréal grâce aux rues partagées.
Et comme le souligne Karel Mayrand, co-président du Partenariat Climat Montréal, beaucoup d’automobilistes avaient déjà renoncé à venir en centre-ville : « Les gens ne viennent plus en voiture parce que c’était infernal le trafic dans le Vieux-Montréal ». Dès lors, la piétonnisation ne fait qu’entériner une réalité et permet de reconquérir l’espace au profit de modes de déplacement plus efficients.
Défendre les rues sans voitures des rues commerçantes ne relève pas du dogme aveugle, mais bien d’une lecture lucide des faits observables. Les commerçants ont raison de se soucier de leur chiffre d’affaires, et il faut les impliquer dans la planification pour atténuer les désagréments et oui, chaque projet doit être adapté, modulé en fonction du contexte local.
Ne vous inquiétez pas, personne ne va dans le Vieux pour s’acheter une télé, ce sont principalement des commerces de vie sociale, nocturne et touristique. Une clientèle principalement déjà sans voitures.
Les résultats mesurés un peu partout tendent à montrer que les rues piétonnes deviennent des pôles d’activité florissants, bien plus vivants que les rues engorgées de voitures qu’elles remplacent.
Plutôt que de céder aux perceptions négatives initiales, il convient d’analyser rigoureusement les données et de faire preuve de vision et d’audace politique. Le Vieux-Port et le Vieux-Montréal ont ce cachet unique qui pourrait très bien devenir à terme, un de ces espaces piétonniers iconiques qui marient patrimoine et dynamisme. Une transformation positive dont les bénéfices, à moyen et long terme, feront mentir les craintes du départ.
Contactez la Société du Vieux-Port et rappelez-leur de façon polie qu’ils sont à Montréal et que vous avez plus de chance d’encourager leurs installations toutes aussi ridicules les unes que les autres si le secteur était plus sécuritaire pour les piétons
(En plus de l’hideuse tyrolienne, qui s’est déjà dit que mettre du bungee dans le vieux était une bonne idée? Peut-être dans une prochaine infolettre)
Sur le Blogue
Depuis 1995, ProposMontréal vous propose de découvrir l'histoire de Montréal sur son blogue. Nouvel article à lire:
La Ginkelvan des Van Ginkel

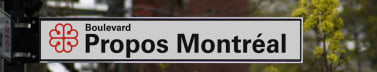












Pourquoi faut-il que ve soit toujours tout ou rien?
La Rambla à Barcelone n'est pas 100% piétonne.
De la Commune est malgré tout un lien est-ouest important. Elle est assez large pour permettre la cohabitation sécuritaire.
Si l'administration du Vieux Port tient aux stationnement c'est parce qu'il y a une demande, le quartier est une destination.
Déjà que le Vieux Montréal est surtout touristique, l'idée de réduire davantage don accès va le transformer en la plus grosse trappe à touristes au Canada. Mauvaise idée.
Pour la Plaza, il faut se rendre à l'évidence, la piétonisation absolue n'amenait pas grand chose de plus avec les trottoirs élargis et la marquise. Fausse bonne idée.
Pour ce qu'il en est de la piétonnisation de la Plaza Saint-Hubert, il serait pertinent de préciser que le 61% des commerçants en défaveur du projet a été obtenue par la firme Raymond Chabot-Grant Thornton en faisant un sondage de 44% des quelques 400 membres de SCD de la Plaza. 61% de 44% représente alors en réalité environ 27%.
https://www.ledevoir.com/economie/824080/vers-fin-pietonnisation-estivale-plaza-saint-hubert